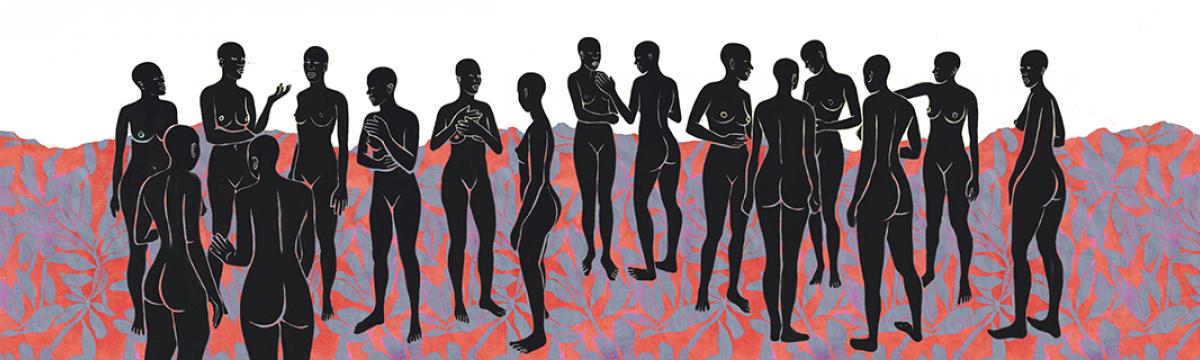Recherche
Dossiers thématiques
Récemment répertoriées
Publications en vedette
En Haïti, il existe un système d'esclavage domestique des enfants qui touche plus d'un enfant sur dix. Connue sous le nom de système restavèk, cette pratique est réputée pour sa cruauté. Il est surprenant de constater que des femmes y sont impliquées de façon importante. Cette thèse s'interroge sur les causes profondes et dynamiques du système restavèk. Selon l'auteure, il semble que les enfants, principale responsabilité des femmes, subiraient les conséquences de l'oppression des femmes, des niveaux extrêmes de violence qu'elles subissent ainsi que du contexte d'extrême pauvreté dans lequel elles survivent.
L’Assemblée des organisations de femmes du 22 mars 1998 créait un comité pour modifier des lois qui ne sont pas formulées dans le meilleur intérêt des femmes haïtiennes. Les négociations ont permis de soumettre au Parlement des changements pour une plus grande réglementation quant au viol, une dépénalisation de l’avortement et de l’adultère et la révision du statut et des conditions de travail des travailleuses domestiques. On explique ici les positions du comité sur ces points et les changements à apporter aux lois actuelles.
Dans cet article, l’auteure postule qu’un modèle de développement qui se veut inclusif permettrait d’éviter des écueils futurs dont l’instabilité politique ou de criantes inégalités, comme c'est le cas aujourd’hui en Haïti.
Au cours du XXe siècle, plusieurs revendications féministes telles que la liberté d’expression, d’association, d’être candidate, d'être élue et d’effectuer des fonctions politiques prennent de plus en plus d'importance. En 1950, les femmes haïtiennes obtiennent le droit de vote et le droit de se présenter aux élections. Cependant, elles ne peuvent toujours pas participer à la politique nationale au même degré que les hommes et ce, malgré l’adoption du principe de quota qui vise l'obtention d'une représentation égale des sexes au niveau politique. L’auteure établit qu’il s’agit d’une mesure insuffisante dans un contexte où la structure de la politique haïtienne discrimine toujours les femmes. Elle propose trois solutions dont de l’aide afin d'accroître la présence des femmes, la remise en question des préjugés sexistes et de la domination masculine ainsi que des mesures pour augmenter le leadership des femmes.
L’économie mondiale stimulée par la croissance économique privilégie les activités entrepreneuriales avec l’aide de programmes. Le développement économique et social se fait à travers la reconnaissance des besoins et l'accès aux processus de production pour tous. Le Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti de 2010 poursuit cette visée en plus de vouloir contrer les inégalités de genre. Comme les femmes apportent déjà beaucoup à l’économie haïtienne sans en être reconnues, l’objectif est de favoriser l’entrepreneuriat féminin par l’autonomisation et l’accès aux secteurs porteurs d’économie afin de valoriser leur travail au sein de la société.